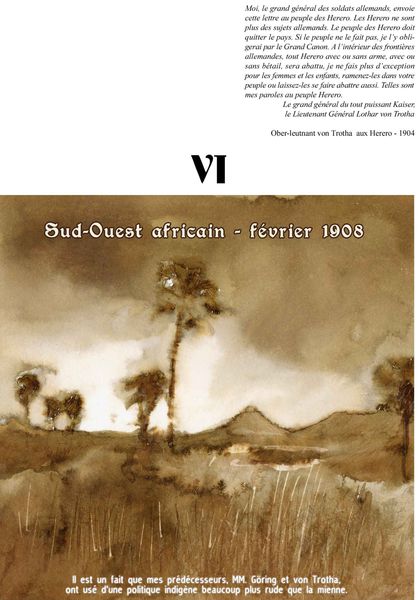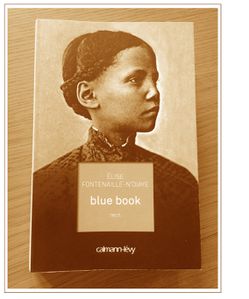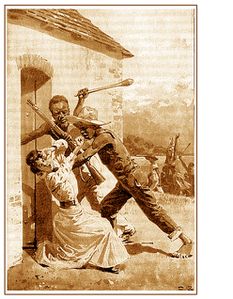Quand j’arrivais à New-York, voici quinze jours, je fus fort surpris de lire sur les journaux de grosses entêtes, telles que « la guerre du kaiser », « l’armée du kaiser », « le kaiser battu », etc... Je crus tout d’abord qu’il y avait là une sorte d’abréviation et que le nom du kaiser était mis à la place de celui de l’Allemagne dans cette guerre, que nous avons été contraints d’entreprendre. Je vis bientôt cependant que l’on voulait dire quelque chose de tout à fait différent et qu’une grande partie du peuple américain était d’avis que l’empereur était plus ou moins responsable de la déclaration de guerre. L’opinion des Etats-Unis était que le peuple allemand, qu’elle connaît cependant pour être bon et pacifique, avait été entraîné dans la guerre grâce aux institutions autocratiques particulières à l’Allemagne, le militarisme notamment.
J’estime donc intéressant d’expliquer ici les bases constitutionnelles sur lesquelles reposent nos institutions. L’empire allemand est l’union de tous les Etats qui appartenaient auparavant à la Confédération germanique, à l’exception de l’Autriche. L’article XI de la constitution allemande dit : « la Confédération sera présidée par le roi de Prusse dont le titre est Deüstcher Kaiser ». Il y a entre la constitution allemande et la constitution des Etats-Unis une grande similitude ; cette dernière est également la réunion d’un certain nombre d’Etats indépendants, qui ont cédé une partie de leur souveraineté au représentant de l’Union. Mais le Kaiser a beau représenter l’empire dans ses relations avec l’étranger, il ne peut cependant pas déclarer la guerre’ au nom de l’empire sans le consentement au Bundesrat de 54 votes égaux. L’empereur, par ses pouvoirs de roi de Prusse, a seulement 17 votes. Il s’ensuit que l’Empereur ne pouvait pas et, en fait, n’a pas déclaré la guerre de son propre chef. Il avait à obtenir et a, en fait, obtenu le consentement de ses alliés représentés par le Conseil Fédéral. Ce consentement fut unanime. Or c’était, à franchir, un obstacle beaucoup plus grand que le contrôle placé par la constitution des Etats-Unis entre les mains du Président, lequel, parmi tous les plus grands monarques de la terre, concentre en lui-même le plus grand pouvoir.
Donc, le Kaiser allemand, pas plus que le Président des Etats-Unis, ne peut faire la guerre quand il lui plaît. Pas davantage l’empereur n’est ce qu’on l’appelle ici, je veux dire « le Seigneur de la guerre ». Il n’a pas la disposition, il n’a pas le commandement absolu des forces de l’armée entière allemande. L’article 66 de notre Constitution dit que les princes allemands, et plus spécialement les rois de Bavière, de Wurtemberg et de Saxe, sont les chefs des troupes appartenant à leur territoire (6 corps d’armée sur 24 en temps de paix). Ils nomment les officiers de ces troupes, ils ont le droit d’inspecter ces troupes, etc... En conséquence, la disposition absolue de l’armée allemande passe au Kaiser seulement au moment où ce consentement de ses alliés, c’est-à-dire des Etats qui avec la Pousse forment l’Empire, a été obtenu et l’autorise à déclarer la guerre. Mais il y a un obstacle encore plus élevé et plus grand aux volontés de l’empereur. Toutes les mesures édictant les conditions et les ressources de la guerre doivent être approuvées par le Reichstag. Le Reichstag est un corps élu par Ië scrutin le plus libéral qui existe, plus libéral même que le scrutin des Etats-Unis pour l’élection du Président. La loi allemande, notamment depuis 1867, exige un vote pour chaque homme, un vote universel, secret et direct. Le peuple allemand est représenté aussi directement et aussi démocratiquement dans son gouvernement que le peuple américain dans le sien. Le droit au vote ne dépend pas d’une censure ou d’une différence d’éducation. Tout Allemand ayant 25 ans et au-dessus peut voter. Le Reichstag compte 397 membres : les Conservateurs, le parti de la guerre, ainsi appelé parce que la plupart de ses membres sont d’anciens officiers, est Une minorité sans espoir ; ils sont environ 55. Il y a 110 socialistes démocrates et environ 100 libéraux. De telle sorte qu’en fait il y a au Reichstag une majorité libérale. Malgré cette composition, le Reichstag a voté à l’unanimité les lois et les crédits, nécessaires à la présente guerre ; les socialistes démocrates, bien que rejetant la guerre par principe dans leur programme, approuvèrent unanimement la politique que leur expliqua le chancelier de l’Empereur. Je dis ceci pour prouver que cette guerre n’est pas une « guerre du kaiser » puisqu’il ne peut pas seul déclarer la guerre, mais bien la « guerre du peuple allemand ». Une guerre moderne, conformément aux grandes idées du prince de Bismarck telles qu’il les exprimait en 1887, avec ses armées énormes comprenant des peuples entiers, ne peut être entreprise avec sûreté, ou faite avec succès, si ne se trouvent pas réunis le consentement unanime et l’aide enthousiaste de la nation entière. Les Américains revenant d’Allemagne vous diront que ce consentement et cet enthousiasme existent au plus haut degré, qu’il n’y a jamais eu une union du peuple allemand et de ses princes, des partis et des croyances, semblable à celle qui existe dans ces temps d’épreuves où pas moins de sept nations se sont données la main pour écraser notre pays. J’entends cependant la réponse ; le militarisme prévaut et domine en Allemagne ; par là le militarisme des autres nations européennes a grandi, jusqu’au jour où la tension devint telle que la corde se cassa; et elle est cassée maintenant. A ceci je réplique que l’Allemagne n’a ni créé, ni favorisé indûment le militarisme en Europe. Le militarisme en Allemagne ne forme qu’une très petite partie de nos préoccupations générales. Nous avons été contraints au maintien d’une armée et d’une flotte par les circonstances, par l’histoire de notre pays et par nos voisins. Nous n’avons pas la plus forte marine, nous n’avons jamais aspiré à l’avoir, pas plus que nous n’avons numériquement la plus forte armée, comme on peut le voir par les journaux américains eux-mêmes qui parlent de 8 à 10 millions de soldats russes; or, l’Allemagne a en effectifs la moitié de ce nombre. Ce n’est pas nous au surplus qui avons commencé à entretenir des armées ou des flottes.
Depuis que la dynastie des Habsbourg se retira plus ou moins du vieil empire allemand pour suivre sa propre destinée et fonder l’Autriche et la Hongrie, mon pays, l’Allemagne moderne, « le saint empire allemand » expression qui fut la risée du monde pendant des siècles, n’a été en somme que l’arène et le champ de bataille des nations européennes ; combattant pour leur suprématie, elles l’ont toutes invariablement choisi. Tout homme qui sait un peu l’histoire sait que dans la guerre de Trente ans (1618-1648) la durée d’une vie humaine, les Français, les Danois, les Suédois, les Polonais, les Autrichiens, les Croates, et même les Espagnols, s’entremêlèrent sur le sol allemand. Cette contrée florissante et prospère fut si entièrement dévastée qu’à la fin de la guerre, elle avait seulement un sixième de ses habitants primitifs. Tout le monde sait ensuite que, comme conséquence de cette déplorable situation, Louis XIV arracha l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne, qui pendant plus de 800 ans en avait été maîtresse ; allié avec les Suédois et les Polonais, Louis XIV déclara ensuite la guerre à la « petite » Prusse et continua ses exploits en sol allemand. Gœthe qui étudia en 1770 à Strasbourg, capitale de l’Alsace, dit dans son « Wahrheitund Dichtung » qu’il ne fallait pas s’étonner de ce que les Alsaciens fussent devenus si peu Français ; en somme le temps fut court pendant lequel ils appartinrent à la France. Au siècle suivant, nous avons le même tableau. Tout le monde connaît la célèbre combinaison Kaunitz ; la Russie et l’Autriche, alliées avec la France et le « saint empire allemand », luttèrent contre Frédéric le Grand pendant sept ans (1756-1763), toujours sur le sol allemand, Quarante ans plus tard, Napoléon transporta la lutte pour la suprématie de la France en Europe, sur ce même champ de bataille où les Allemands et les Autrichiens, les Russes et les Suédois se donnèrent l’un l’autre rendez-vous pour vaincre la France ; ce fut là une autre guerre de sept ans, d’Iéna à Leipzig. La situation de l’Allemagne au milieu de l’Europe, aussi longtemps surtout qu’elle fut sans pouvoir, sans influence et divisée en un nombre de petits États qui rendaient difficile la solution des questions européennes, lui valut toujours d’être le champ de bataille des nations.
L’Angleterre possède une grande flotte depuis le règne d’Henri VIII au XVIe siècle ; elle emploie cette flotte à maintenir sa prépondérance absolue sur mer en combattant toujours le peuple qui veut rivaliser maritimement avec elle, qu’il soit Français, Espagnol, Hollandais ou Russe. La Russie et l’Autriche ont eu pendant des siècles leurs armées derrière elles ; il en fut de même de l’Espagne, surtout de la France. Il n’y avait pas d’armée allemande parce qu’il n’y avait pas d’unité allemande. L’armée prussienne fut réorganisée seulement en 1863 grâce aux forces intérieures de 25 petits Etats. Après la défaite des forces napoléoniennes, mon pays attendait des jours meilleurs, mais le contraire advint. Trois grands diplomates se concertèrent pour maintenir l’Allemagne dans une faible condition : le prince Metternich, premier ministre autrichien, le prince Talleyrand, l’envoyé français si habile, et Lord Palmerston. Les guerres de Napoléon se terminèrent au Congrès de Vienne en 1815. L’Allemagne sortit humiliée du Congrès sans puissance et sans défense, elle dut créer pour vivre la «Confédération germanique». La Hollande, et plus tard la Belgique, qui avait formé jusqu’en 1830 la partie sud de la Hollande, furent constitués Etats neutres, afin que l’Angleterre n’eut à craindre aucune puissance de l’autre côté de la Manche ; la France s’arrangea pour être entourée de tous les côtés par des voisins absolument inoffensifs. La jalousie, à l’égard de la Prusse, de l’Autriche alors en relations avec l’Angleterre et les ambitions françaises ne permirent pas à la race allemande de devenir une nation et de fonder son unité nationale. Quand la Belgique se sépara de la Hollande, les puissances choisirent un roi qui fut à la fois le gendre du roi de France et l’oncle de la reine d’Angleterre, par conséquent fortement lié avec ces deux pays.
La Confédération germanique, dans laquelle la Prusse avait un vote sur dix-sept, fut intentionnellement établie comme une machine inutilisable, puisqu’on demandait l’unanimité des votes pour chaque mesure importante. Telle fut la situation que Bismarck trouva quand, en 1852, il fut envoyé par la Prusse à la Fédération de Francfort.
Il se rendit bientôt compte du manque d’appui de la Prusse, de la misère qui s’ensuivait pour l’Allemagne. Il décida que, si le peuple allemand voulait devenir une nation et avoir une puissance proportionnelle à sa population et à ses ressources, la domination de l’Autriche devait cesser tout d’abord. Ainsi éclata la guerre de 1866. Le Norddeutscher bund suivit, et la guerre commune de toutes les provinces germaniques contre la France souda l’Allemagne et l’Empire. L’histoire, cependant, avait enseigné à .Bismark que cet empire ne pouvait vivre et prospérer, enfermé comme il l’était dans le milieu de l’Europe, entre les grandes puissances, s’il n’avait une armée suffisamment forte pour défendre ses frontières contre une attaque et une invasion. L’Allemagne nouvelle devait agir comme ses voisins l’avaient fait auparavant, c’est-à- dire créer et maintenir une grande force pour sa sauvegarde et sa tranquillité, pour le développement de ses avantages internationaux et sa prospérité intérieure.
Ainsi l’Allemagne, puissance militaire et navale, fut créée dans un but purement défensif; ses alliances furent conclues aussi dans un but défensif. L’Allemagne détient parmi les nations d’Europe le record de la paix à l’intérieur et à l’extérieur, puisqu’elle n’a fait aucune guerre durant les quarante-quatre dernières années. Elle n’a jamais convoité les territoires, ni les colonies de ses voisins ; elle n’a jamais été en révolution à l’intérieur, ni en guerre à l’extérieur ; on ne peut pas en dire autant de tous ses voisins et adversaires.
Passons en effet les événements en revue. Depuis 1870, l’Angleterre a conquis l’Egypte, bombardé Alexandrie, pris par la force les deux républiques boers ; elle a ajouté à sa sphère, par violence, le sud de la Perse, èt par intimidation une partie du Siam. La France a conquis Tunis, s’est battue au Maroc, a fait la guerre à Madagascar, essayé de prendre le Soudan et conquis l’Indo-Chine dans une guerre sanglante. La Russie a combattu les Turcs en 1878 et les Japonais en 1904. Elle a pris à la Chiné la partie nord de la Mandchourie et toute la Mongolie ; elle a fait la guerre en Turkestan ; elle a mis dans son sac la partie nord de la Perse, elle a formé et soutenu la combinaison balkanique ; elle s’est montrée la plus agressive des puissances européennes. Pendant ce temps l’Allemagne a ajouté à son territoire seulement certaines possessions coloniales qui lui furent toutes cédées par arrangements pacifiques et du consentement commun des grandes puissances. Willed Grass, un des mandants américains du Lene Lenape, déclarait jadis dans sa pétition de 1852 à la Chambre de New-Jersey pour les compensations dues à sa région en échange des droits de pêche abolis : « Pas une goutte de notre sang vous « n’avez répandu dans une bataille, pas un are de notre « terre vous n’avez pris sans notre consentement. » C’est le cas de mon pays dans ses acquisitions territoriales depuis 1870 ; toujours l’Allemagne s’est montrée respectueuse envers les puissances européennes. L’Allemagne s’est montrée la nation d’Europe la plus pacifique, sans excepter l’Espagne et l’Italie.
Le militarisme joue un rôle bien moindre dans la vie nationale allemande, que dans aucune autre nation. Les Américains, dans leur amour du libre arbitre et du jeu loyal, ont reconnu les progrès que ma patrie a faits dans les arts de la paix, dans les sciences et la technique industrielle, dans le commerce et l’industrie. Nous avions mieux à faire en effet que de songer à attaquer d’autres pays. Nous avons créé une grande marine marchande, la deuxième du monde. Nous avons un commerce extérieur qui vient immédiatement après celui de l’Angleterre ; car Londres continue à être la « Salle de réunion pour balance des comptes entre les banquiers du monde ». Nous avons développé nos Universités, qui sont aujourd’hui visitées par des étudiants de toutes les parties du monde. Notre législation a été modifiée dans l’intérêt du travailleur. L’Allemagne a été la première à introduire dans Ses lois l’assurance nationale pour parer aux conséquences des accidents, de la maladie, de la vieillesse, du veuvage, etc... Nos progrès techniques sont incontestés. Nos industries électriques et nos industries chimiques ont conquis les marchés du monde. Les teintures et les produits pharmaceutiques allemands Salvarsan, le sérum Behring et autres, sont demandés partout. L’Allemagne a été le premier pays à vouloir l’éducation primaire obligatoire. Les travaux de ses peintres et de ses artistes sont connus de tout l’univers. Enfin, un de ses plus grands mérites a été de développer l’agriculture au même titre que les beaux-arts. Par-là, nous avons donné à notre pays la possibilité de Se suffire à lui- même ; il peut presque se passer des denrées et des produits alimentaires de l’étranger. A tous ces divers travaux, le Kaiser a apporté la plus grande activité et témoigné le plus vif intérêt. N’est-il pas depuis longtemps reconnu que ses préférences vont à tout développement pacifique? Cela n’a-t-il donc aucune signification qu’il ait figuré sur la liste des candidats pour le prix Nobel de la paix ? Toute notre activité nationale du reste suppose l’état de paix dans l’univers. Il aurait été fou pour nous de mettre en mouvement de si nombreuses entreprises, si l’idée d’une guerre d’agression ou de provocation avait été dans l’esprit de l’empereur ou du peuple. On ne peut nier que tout ceci a été le travail des dernières quarante années. Avant cette époque, l’Allemagne était connue et tournée en ridicule comme un pays de « poètes » et de < penseurs ». N’est-ce pas le même peuple qui a tant fait cependant pour la civilisation? Pourquoi n’avons- nous pas fourni auparavant les traits caractéristiques dont je viens de parler? Pour les raisons que j’ai justement exposées. Sans unité, sans liberté, sans sécurité, vivant toujours sous la crainte d’une intervention extérieure, nous ne pouvions développer nos propres tendances, ni travailler à notre avenir. Un peuple, qui toujours a peur d’être envahi de toutes parts, d’être l’otage des puissances qui se disputent la suprématie européenne, ne peut rien faire dans les travaux de la paix ; il ne peut rien acquérir de l’activité et des moyens, qui sont la base de tout grand progrès commercial et industriel. La même argumentation peut être présentée en faveur des colonies allemandes, que nous exploitions dans des buts humanitaires, et qui sont devenues une valeur qui s’ajoute aujourd’hui à notre production intérieure. Mais le merveilleux développement de l’Allemagne, l’augmentation continuelle de sa richesse, la concurrence acharnée qu’elle faisait aux vieilles nations sur les marchés du monde, ont excité la jalousie de ses voisins. On ne peut pas s’étonner dès lors que ceux-ci aient saisi l’occasion de donner ce qu’ils appellent « une leçon à l’Allemagne ».
Venons-en maintenant aux raisons de la présente guerre. L’univers est devenu plus démocratique dans le dernier demi-siècle. La puissance et l’influence des dynasties ont été remplacées sur une grande échelle par l’esprit de nationalisme et d’affirmation de la race sur les autres races. C’est le peuple qui contrôle maintenant le cours de la politique européenne et américaine. Plus forts deviennent le nationalisme et le sentiment national, et moins les dirigeants sont contrôlés. Ceci est advenu principalement en Russie qui, en dépit de l’autocratie de sa constitution, a forcé le tzar à s’enrôler sous la bannière du panslavisme. Le panslavisme signifie le ralliement de tous les peuples de race slave sous la domination ou le protectorat du tzar blanc. Jusqu’à quel point le panslavisme a contraint la Russie au protectorat des Balkans, c’est ce qu’on peut voir dans l’extrait suivant du Livre Blanc anglais, numéro 139 : Sir G. Buchanam écrit ainsi à Sir Edward Grey : « M. Sazonoff a « informé l’ambassadeur français et moi-même, ce « matin, de sa conversation avec l’ambassadeur autrichien. Il en est venu à dire que, durant la crise balkanique, il avait clairement démontré au gouvernement « autrichien que la guerre avec la Russie suivrait inévitablement une attaque de l’Autriche contre la Serbie.
« Il est clair que la domination autrichienne de la « Serbie était aussi intolérable pour la Russie que la « suprématie allemande en Hollande serait intolérable à « l’Angleterre. C’était en fait pour la Russie une question de vie ou de mort. » Vous voyez : c’était une question de vie ou de mort pour la Russie que la Serbie ne fût pas attaquée. Tout le monde sait qu’une grande partie des peuples slaves fait partie de l’empire autrichien. Sur une population totale en 1910 de 51 millions en Autriche-Hongrie, on comptait 20.500.000 Slaves. Les prétentions du panslavisme, à savoir que tous les Serbes et tous les Slaves doivent dépendre de la Russie, que tous les Slaves seront protégés par la Russie, ne signifie rien moins que l’anéantissement de l’Autriche. C’est ce que l’Autriche exprima fortement dans son ultimatum. Que cette guerre apparaisse, maintenant, comme une conséquence de l’assassinat de l’archiduc-héritier d’Autriche, c’est ce qui est de peu d’importance. Elle pouvait éclater dans n’importe quel cas ; sinon aujourd’hui, du moins demain, aussi longtemps que la théorie de M. Sazonoff aurait persisté. Aucune médiation internationale, aucun arbitrage, de quelque nature qu’ils fussent, n’auraient empêché le choc de se produire aussi longtemps que l’ambition et le prestige russes exigeaient ces desseins. Et que ceci soit bien la théorie panslaviste
et ait été au moins depuis 1878, chaque lecteur de la presse américaine peut en témoigner. On lit dans le New-York Times du 10 septembre 1914 : Remaniement de la Garde de l’Europe. Vues russes sur le partage final des territoires — Petrograd, 8 septembre. Le « Pretch déclare que la guerre doit être terminée de telle façon qu’elle ne laisse aucune association capable de se venger d’aucun côté. Les changements dans la carte d’Europe doivent s’opposer à la satisfaction des ambitions légitimes allemandes. Il faut donner satisfaction aux ennemis de la Prusse en Allemagne même. Il ne faut plus de divisions de la Pologne ; il faut réviser le traité de Bucarest. L’unification de la Russie, de l’Italie, de l’Allemagne, de la Roumanie et de la Serbie doit être complétée. La France doit recouvrer ce qu’on lui a pris et, du côté turc, la Bulgarie également. Une lutte de cent ans pour le principe des nationalités doit se terminer par des décisions libérées de tout compromis et par conséquent définitives.
Ces idées semblent avoir plusieurs avocats en Amérique. De l’existence nationale de l’Autriche on ne peut cependant pas discuter. Ce n’est pas trop dire que, même le tzar l’eût-il voulu, il n’aurait pu empêcher son développement. L’anéantissement de l’Autriche-Hongrie ne peut en outre être toléré par l’Allemagne. L’Autriche est la seule aide que possède l’Allemagne pour sa défense, la seule amie sur laquelle elle puisse compter; L’anéantissement de la monarchie dualiste et l’isolement, absolu de l’Allemagne rendraient celle-ci une proie facile, toutes les fois que ses voisins voudraient l’attaquer.
Sir Edward Grey a dit de la France qu’elle avait pp prendre part à la lutte, comme conséquence d’une alliance fixe et par question d’honneur national. Ceci est exact. Le point de savoir si ainsi la politique française est sage ou ne l’est pas ne souffre pas discussion. Mais là France a certainement été mal inspirée de se lier à une puissance dirigée par des instincts de race, et dont elle ne peut contrôler ni les buts, ni les aspirations. En prêtant à la Russie dix milliards de francs, elle s’est mise dans le cas de subir une guerre; or, tandis qu’elle est la créatrice de la machine de guerre russe, elle reste indirectement le champ de bataille des aspirations russes, puisque la France est l’otage de l’Allemagne pour la conduite de la Russie dans l’avenir. La politique anglaise fut toujours, pendant des siècles, de maintenir l’Europe dans un équilibre des fortes tel que l’Europe se trouvât divisée en deux camps d’antagonistes aussi égaux et équivalents que possible ; cependant l’Angleterre gardait Une main libre pour que, de quelque côté de la balance que cette main pesât, le plateau de la balance descendit. Que l’Angleterre ait eu quelque répugnance d’entrer en guerre et que les efforts ae Sir Edward Grey aient été très sérieux et très actifs pour éviter le choc (efforts pas plus sérieux cependant que ceux de l’empereur allemand et de son chancelier) c’est ce dont personne ne doute et que chacun comprend. Mais quand il fut bien clair que la Russie n’écouterait aucun avis et que la France s’engagerait dans le conflit, l’Angleterre alors, à Cause de sa théorie de l’équilibre européen fit pression delà main sur la balance.
En 1870, 38 millions d’Allemands combattirent 40 millions de Français. Lorsque l’Alsace-Lorraine fit retour à l’Allemagne, la proportion fut renversée. L’Allemagne avait 40 millions, la France en avait 38. Mais, tandis que l’Allemagne faisait de grands progrès en population, sans addition de territoire, et arrivait à plus de 60 millions d’habitants, la France restait absolument stationnais avec 38 millions d’habitants. Il était clair dès le début que, dans une lutte européenne, la France serait terrassée par le poids du nombre et que l’équilibre européen, qui était la théorie de l’Angleterre, s’évanouirait pour toujours, si l’Angleterre ne mettait pas la main dans l’affaire. On a coutume de dire que l’Angleterre est entrée en guerre à la suite de la violation de là neutralité belge. Sir Edward Grey, que je connais depuis longtemps et que j’ai toujours considéré comme un diplomate supérieur et un gentilhomme, n’a jamais dit que la violation de la neutralité belge fut la raison, et encore moins la seule raison de la participation de l’Angleterre au conflit. Sa théorie, il l’exprima dans son discours à la Chambre des Communes le 3 août ; il s’appuya dans ses déclarations, sur le discours de M. Gladstone à la Chambre des Communes le 8 août 1870. Cette citation est la suivante : « J’admets qu’il y a l’obligation du traité... Mais je ne puis souscrire à la doctrine que le simple fait de l’existence d’une garantie y lie chaque « partie sans tenir compte de la position particulière « que chacune de ses parties pourra avoir au moment où l’occasion d’agir en vertu des garanties se produira. Les grandes autorités en matière de politique étrangère... comme lord Aberdeen et Lord Palmer n’ont, à ma connaissance, jamais pris de position rigide, et je puis m’aventurer à le dire, 4e position impraticable en matière de garantie. La circonstance qu’il y a déjà une garantie nette est nécessairement un fait important et un élément de poids dans le cas. Mais il y aussi cette autre considération, dont nous devons tous sentir profondément la force,: c’est que nos intérêts contre l’agrandissement immesurée d’une puissance quelle qu’elle soit sont primordiaux. »
Ceci signifie que le traité concernant la neutralité belge n’obligeait pas l’Angleterre à maintenir celle-ci. Ce fut l’avis de M. Gladstone aussi bien que l’opinion de Sir Edward Grey que cette neutralité serait maintenue seulement si l’intérêt particulier de l’Angleterre le commandait. Donc ceci signifie également que le traité de garantie ne liait l’Allemagne que dans les mêmes conditions ; c’est-à-dire si sa position particulière lui permettait, en matière de neutralité belge, de maintenir celle-ci. L’Allemagne a offert à la Belgique l’intégrité territoriale et une indemnité que celle-ci refusa. Sa position particulière lui commandait de marcher à travers la Belgique. Ceci, d’après M. Gladstone, elle avait le droit de le faire. M. Ramsay Mac Donald, le grand leader ouvrier anglais, attaquant Sid Edward Grey dans le « leader labor » de Manchester a commenté sévèrement le point de vue anglais. Il a dit (New-York Evening Post du 8 septembre) : « Si la France avait décidé d’at- « taquer l’Allemagne par la Belgique, sir Edward Grey « n’aurait pas fait d’objection, mais se serait justifié par « l’opinion de M. Gladstone. » Chaque lecteur impartial de la citation ci-dessus sera d’accord sur ce point. Le point saillant est que, pour employer les mots de M. Gladstone, l’Angleterre était effrayée d’un agrandissement immesuré de l’Allemagne. », et que c’est la raison pour laquelle Londres se résolut à défendre la neutralité belge-. Tel était son intérêt, telle est bien la théorie de M. Gladstone que sir Edward Grey donne comme règle à l’attitude anglaise. L’Angleterre fut la première puissance du monde durant plusieurs siècles et Sir Edward Grey n’avait pas l’intention d’aliéner légèrement cet héritage.
C’est également la raison pour laquelle on demanda à l’Allemagne de n’attaquer aucune des côtes françaises après que la France, avec le consentement de l’Angleterre, eut concentré sa flotte dans la Méditerranée. Sir Edward Grey dit dans le même discours : « Les côtes françaises sont également sans défense. La flotte française est dans la Méditerranée et y sera concentrée pendant quelques années à cause du sentiment de confiance et d’amitié qui existe entre nos deux pays. » Et il continue : « Mon propre sentiment est que, si une flotte étrangère, engagée dans une guerre que la France n’aura pas cherchée (ce qui n’est pas très exact) et « dans laquelle elle ne serait pas l’agresseur, entrait dans la Manche, bombardait et battait les côtes sans défense « de la France, nous ne pourrions pas rester neutres, etc... ».
Ainsi l’Angleterre jugeait nécessaire de prescrire à l’Allemagne le point par lequel celle-ci attaquerait la France ; mais la mer était interdite parce que les côtes françaises étaient sans défense, et aussi la Belgique parce que la neutralité belge était un élément essentiel dans la politique d’équilibre de l’Angleterre. Si deux locomotives s’écrasent l’une contre l’autre, les tampons sont les premières parties à souffrir. Un choc est survenu entre l’Angleterre et l’Allemagne, occasionné par le fait que l’Angleterre voulut prendre la défense de la France ; il ne faut pas s’étonner que la première chose sur laquelle nous ayons foncé soit l’Etat-tampon qui devait servir à garder les deux puissances séparées et affaiblir, en faveur de l’Angleterre, sa rivale de la mer du Nord.
Ceci est à mon avis l’histoire du développement de la présente lutte. C’est l’agitation panslaviste et l’obligation pour le tzar de maintenir le prestige de la Russie, qui le forcèrent à rompre avec l’Autriche. Ce fut une nécessité pour l’Allemagne, et je puis ajouter ici, un devoir, en application du traité de 1879, de venir à l’aide de l’Autriche et de la protéger contre la destruction et le démembrement. Quiconque dit que l’Allemagne aurait dû abandonner l’Autriche ou lui donner le conseil de céder devant les prétentions russes, demande à l’Allemagne de commettre un acte déloyal, de rompre les obligations les plus solennelles et de souscrire à la théorie du « chiffon de papier » qui est si attaquée. Car, pour venir au fait, la théorie du « chiffon de papier » n’est pas d’invention allemande, mais bien d’invention anglaise, comme nous l’avons prouvé plus haut. Ce n’était pas seulement son traité avec la monarchie dualiste, mais l’attitude hostile de ses voisins qui forçait l’Allemagne à se mettre aux côtés de l’Autriche. La France devait entrer dans le conflit, c’était fatal ; elle avait le même traité avec la Russie que nous avec l’Autriche. Mais comment et pourquoi les intérêts de l’Angleterre lui dictèrent d’aider la France, c’est ce que j’ai justement essayé d’exposer : l’Angleterre incarne le trouble qui pesait sur l’Europe depuis nombre d’années. Il est d’autre part ridicule de considérer la Russie, terre des « pogroms » et des horreurs sibériennes, comme une puissance européenne de progrès, comme un bouclier de libéralisme, comme un artisan de la liberté grandissante. Opinion regrettable comme regrettable aussi la pesée de l’Angleterre qui, par intérêt, a contraint la France de devenir l’alliée de la Russie.
Je crois qu’on ne verra la fin de toute cette lutte que quand les nations d’Occident vraiment éprises de progrès, conduites par l’Allemagne et l’Angleterre, joindront leurs mains et rendront à l’Europe la paix sur des bases honnêtes et équitables. Cette conclusion dépend de l’esprit des différents peuples. L’Allemagne ne désirait pas cette guerre ; on l’y a forcée. L’Autriche la considérait comme une nécessité nationale: certainement elle ne la désirait pas. La France ne désirait pas la guerre; elle y apportait un trop gros enjeu. L’Angleterre ne désirait pas la guerre ; elle pouvait s’estimer satisfaite de l’état de l’Europe avant que la guerre n’éclatât. Ce fut la tendance panslaviste, qui obtint le meilleur des vues les plus saines du tzar russe, lequel mit la balle en mouvement. Dans cette lumière des faits, on n’a pas besoin de demander si le différend entre l’Autriche et la Serbie pouvait être réglé par l’arbitrage ou non. Ce sont là des questions d’existence nationale et d’honneur qui ne se prêtent pas à l’arbitrage. La théorie panslaviste, qui prétend amener tous les Slaves sous le pouvoir du tzar, menaçait de diviser l’Autriche et même de la rayer du concert européen. La Serbie fut utilisée comme instrument et sa cause introduite dans la politique intérieure de sa voisine. Les documents contenus dans l’ultimatum autrichien le prouvent surabondamment. Il est également inutile d’essayer de prouver que l’Allemagne commit une grande erreur en violant la neutralité belge. M. Gladstone a ruiné ce point de vue une fois pour toutes et Sir Edward Grey est avec lui. Tout ceci prouve un état très triste des affaires et a produit des conséquences sérieuses. Mais il n’est pas inutile de disputer de ces incidents, afin d’éviter le grand problème. Ce grand problème a été et est aujourd’hui de savoir si les Slaves gouverneront de la mer japonaise à Berlin, et encore plus loin à l’Occident, ou si l’Allemagne, même en lutte avec ses voisins civilisés de l’Ouest, restera debout pour maintenir la civilisation européenne et la sauver de la domination du « knout ».
(Signé : Dr Dernburg.)